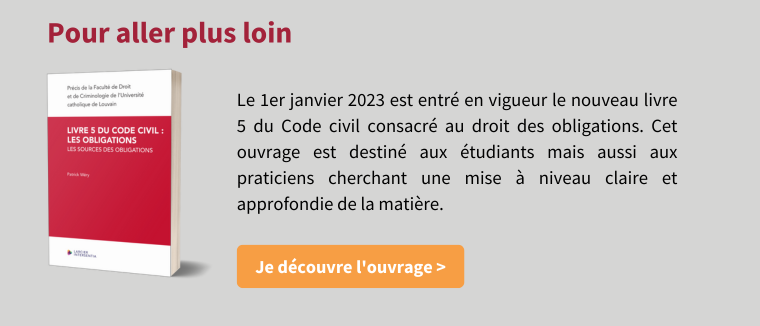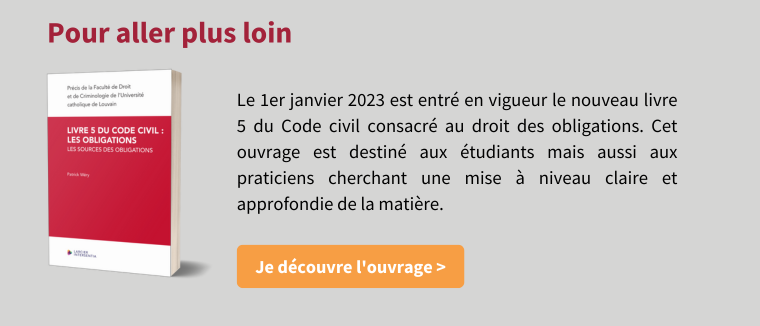Livre 5 du Code civil : les obligations
Entretien avec Patrick Wéry


Patrick Wéry est professeur ordinaire à la Faculté de droit et de criminologie de l’UCLouvain, où il enseigne notamment le droit des obligations et les contrats spéciaux.
Vous avez publié en 2021 la troisième édition de votre précis consacré à la théorie générale du contrat. Pourquoi publier, 3 ans plus tard, un nouvel ouvrage de droit des obligations ?
Pour le comprendre, il faut remonter au mois de juillet 2015, lorsque le ministre de la Justice de l’époque Koen Geens nous a chargés, feu le professeur Eric Dirix et moi, de coordonner une réforme du Code civil ; il était grand temps, car bon nombre de dispositions remontaient à 1804 et accusaient le poids des ans. Dans la foulée, diverses commissions d’experts ont été installées, dont la commission de réforme du droit des obligations, dont j’ai eu le privilège et le plaisir d’assurer la présidence avec la professeure Sophie Stijns de la KULeuven.
Après diverses péripéties d’ordre politique sur lesquelles je ne vais pas m’appesantir, le législateur a adopté en 2022 le livre 5 du Code civil portant le droit des obligations, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2023.
Cette réforme n’entend pas révolutionner la matière de fond en comble. Elle le fait évoluer en consacrant une série d’acquis doctrinaux et jurisprudentiels qui avaient été engrangés sous l’ancien Code civil ; je songe, par exemple, à l’article 5.37 relatif à l’abus de circonstances ou à l’article 5.73 qui traite de l’exécution de bonne foi des conventions. Suivant les suggestions des experts, le législateur comble aussi certaines lacunes de l’ancien code que la jurisprudence n’avait pas pu ou voulu pallier. Un exemple emblématique me vient à l’esprit : la consécration de l’imprévision, du changement de circonstances (art. 5.74).
Cette réforme justifiait évidemment que je reprenne la plume pour commenter le livre 5. Je me suis toutefois borné, à ce stade, à présenter les sources des obligations. Le chantier est, en effet, énorme.
À quel public s’adresse cet ouvrage ?
L’ouvrage s’adresse tout d’abord aux étudiants qui suivent un cours d’obligations ou qui doivent rédiger un travail dans cette matière. Il ambitionne aussi d’intéresser les praticiens qui, quelle que soit leur profession, sont confrontés à des questions de droit des obligations. Certains le pratiquent au quotidien ; d’autres, de manière moins fréquente. Mais aucun juriste ne peut se targuer d’y échapper complètement.
Comment se structure l’ouvrage ?
Après une introduction visant à situer la réforme du droit des obligations dans son contexte et à définir l’obligation, l’ouvrage présente les sources des obligations en suivant la summa divisio retenue par le législateur.
D’abord, l’étude des actes juridiques. De longs développements sont consacrés aux contrats avec toutes les questions traditionnelles qui peuvent surgir, allant de la négociation du contrat à l’extinction de celui-ci.
Après les actes juridiques vient l’étude des faits juridiques. En l’espèce, les quasi-contrats que sont la gestion d’affaire, le paiement indu et l’enrichissement injustifié. La responsabilité extracontractuelle – qui est au cœur du livre 6 du Code civil – n’est pas étudiée en tant que telle dans mon ouvrage. Sur ce point, je m’en remets à mes collègues qui enseignent la matière.
Conseillez-vous aux juristes qui souhaiteraient faire de la place dans leur bibliothèque de jeter votre volume de 2021 consacré à la théorie générale des contrats et celui de 2016 consacré au régime général de l’obligation ? Ils commentaient, en effet, l’ancien droit des obligations…
Certainement pas ! Sans entrer ici dans trop de détails, les dispositions de droit transitoire qui figurent dans la loi portant la création du nouveau Code civil précisent que tous les actes juridiques et les faits juridiques antérieurs à l’entrée en vigueur du livre 5 – pour rappel le 1er janvier 2023 – restent régis par les dispositions qui étaient en vigueur à l’époque, donc par les articles 1101 et suivants de l’ancien Code civil, tels qu’ils ont été interprétés par la doctrine et la jurisprudence. L’ancien droit des obligations a donc encore de belles années devant lui.
Par contre, et ici aussi sans entrer dans trop de détails et de nuances, les actes juridiques et les faits juridiques accomplis au-delà du 31 décembre 2022 sont soumis au livre 5 du Code civil.
Les praticiens vont donc devoir, pendant de nombreuses années, jongler avec l’ancien et le nouveau droit des obligations.
Cet ouvrage aura-t-il une suite ?
J’y travaille. Le second volume sera consacré au régime général de l’obligation et traitera de questions aussi diverses que les modalités des obligations, l’inexécution de l’obligation et ses suites, les causes d’extinction des obligations ou encore la transmission des obligations. Ce qui correspond au titre 3 du livre 5 du Code civil. Ici aussi, suivant les suggestions des experts, le législateur a, sur bien des points, légiféré à droit constant. Plusieurs nouveautés remarquables sont toutefois à mettre au crédit de la réforme, dont les moindres ne sont pas une simplification du régime des obligations à pluralité de sujets et l’adoption de textes relatifs à la cession de dette et de contrat.
Tout comme le précis consacré aux sources, cet ouvrage sera écrit à un seul clavier. Pour m’aider dans ce projet, je pourrai heureusement compter, à nouveau, sur le soutien logistique de Damien Ugeux et Caroline Manesse, respectivement secrétaire et documentaliste du Centre de droit privé, ainsi que sur l’efficace équipe de la maison d’édition Larcier-Intersentia et du Répertoire notarial.